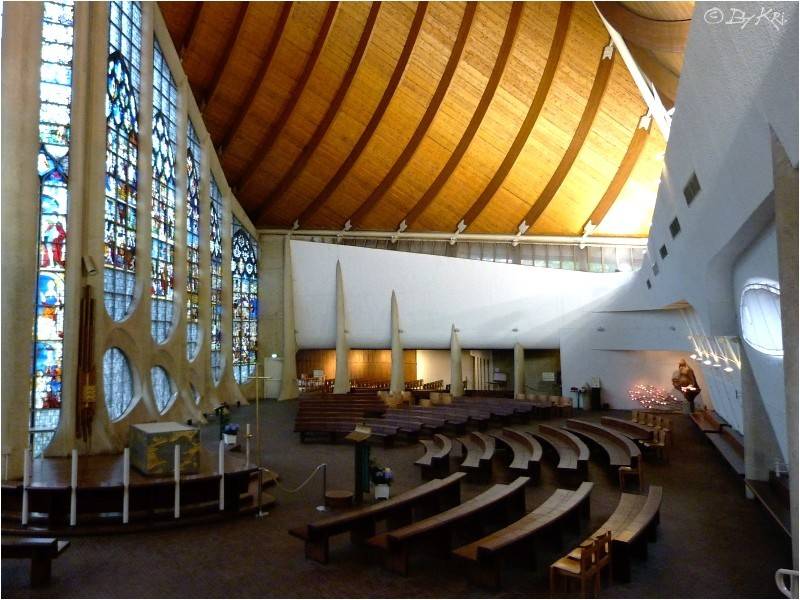La présente réflexion pourrait être intitulée : Non à une Eglise catholique qui serait « postmoderne pour les postmodernes » : non, en effet, à une Eglise catholique qui croirait pouvoir être, ou qui voudrait pouvoir être désormais, avant tout, notamment, ou seulement, dotée d’une mentalité postmoderne, en direction ou au service du monde contemporain et postmoderne.
Certes, le monde contemporain a changé d’univers mental, après 1945, même si l’on ne s’en est pleinement aperçu que juste après le milieu des années 1960, mais ce n’est pas parce que le monde contemporain a changé d’univers mental que l’Eglise catholique doit, elle aussi, changer d’univers mental, et doit le faire coûte que coûte, à tout prix, ou doit se déconfigurer puis se reconfigurer « au fur et à mesure », de changement en changement, au point de préférer la « sequela mundi » à la Sequela Christi, ou au risque de subordonner l’Imitation de Jésus-Christ à l’intégration des valeurs du monde de ce temps.
I.
- D’une part, à ce petit jeu-là, l’Eglise catholique sera toujours en retard d’un changement d’univers mental, d’autre part, le changement d’univers mental dont il est question ici n’est certes pas un changement d’univers mental purement formel et purement ponctuel, artificiel ou superficiel, non potentiellement hégémonique ni potentiellement irréversible, enfin, ce changement d’univers mental a une caractéristique religieuse, une signification spirituelle, à la fois postchrétienne et postmoderne, que j’évoquerai en fin de texte, et qui est bien plus souvent dissimulée aux fidèles catholiques par les clercs catholiques qu’elle ne leur est précisée ou rappelée, avec insistance et avec lucidité.
- Il se trouve qu’il y a une incompatibilité fondamentale entre l’introduction, sinon la domination, de la mentalité postmoderne dans l’Eglise catholique, et le maintien en vigueur, et en plénitude, dans l’Eglise catholique, des principes et des pratiques qui permettent de prioriser la réception et la transmission, pensées et vécues dans la Foi, l’Espérance et la Charité,
– des catégories et des comportements, des conceptions et des distinctions, des définitions et des oppositions,
– des différenciations et des hiérarchisations, des médiations et des positions, de la prédication et de la pastorale,
qui contribuent grandement, et qui sont mêmes indispensables
– à la connaissance de la Parole de Dieu, à la compréhension du message de Dieu, à la fidélité à la volonté de Dieu,
– au respect et au souci de la liturgie, des sacrements, à la contemplation des mystères de Dieu, à l’adoration des Personnes divines.
- On rappellera ici qu’il s’agit du seul vrai Dieu, Père, Fils, Esprit, la mentalité postmoderne présente au sein ou, en tout cas, autour de l’Eglise catholique, ayant précisément horreur de ce type de rappel, car pour elle cette précision est « dépassée », est « injuste », est « insensée », ou est une « prétention »… »ringarde » ou « stupide ».
- Mais quelles sont les caractéristiques fondamentales de la mentalité postmoderne, et en quoi ces caractéristiques fondamentales sont-elles incompatibles avec les caractéristiques fondamentales du christianisme catholique ?
- D’une manière générale, le postmoderne
– n’a pas « le culte de l’homme » ni « la passion de la raison », dans l’acception humaniste européenne, « classique moderne », de ces termes, acception que l’on peut rencontrer chez des disciples de Descartes, de Locke, ou de Kant,
mais
– a le culte du Moi, de l’Autre, du Nous, au moyen
- a) de sensations et de sentiments individuels « alter-égoïstes », agréables pour le Moi, ouverts sur l’Autre, partageables au sein du Nous,
- b) d’une sensibilité festiviste ou hédoniste et d’un sentimentalisme humanitariste,
- c) d’une solidarité humaine « vivre-ensembliste » sans ouverture sur la transcendance divine.
- Pour le postmoderne, par exemple, toute différenciation ou toute hiérarchisation explicite et objective, bien critérisée et bien délimitée, en matière religieuse, morale, culturelle, sexuelle, est synonyme de discrimination arbitraire, et est l’antichambre de bien des dominations et de bien des injustices, de bien des exclusions et de bien des oppressions. Mais en quoi donc un ensemble de délimitations ou de hiérarchisations est-il nécessairement générateur de surdéterminations asservissantes, et en quoi donc un ensemble d’indélimitations ou d’indifférenciations est-il salutairement générateur d’indéterminations authentiquement émancipatrices, au coeur de l’individu, et effectivement unificatrices, entre les individus ?
II.
- D’une part, il n’est pas exagéré de dire qu’une Eglise catholique qui se mettrait en conformité avec la mentalité postmoderne serait contrainte, pour pouvoir le faire, de démanteler ou de neutraliser, de dénormativer ou de désobjectiver, de décolorer ou de déstructurer, de relativiser ou de subjectiviser, une très grande partie de ce qui fait que le christianisme catholique résiste encore à l’esprit du monde, se transmet encore, de générations en générations, et surtout, s’inspire encore de la Parole de Dieu, communique encore la Grâce de Dieu, coopère encore avec la Grâce de Dieu, reçoit et transmet encore l’Amour et la Lumière de Dieu.
- D’autre part, il n’est pas exagéré de dire que la mentalité postmoderne n’est pas seulement postmoderne : elle est aussi postchrétienne et, implicitement ou indirectement, anti-chrétienne, en ce qu’elle fonctionne à un antichristianisme qui se veut « light » et « soft », par arguments axiologiques situés au croisement de l’herméneutisme et de l’historicisme, et par hégémonie intellectuelle médiatiquement et mondialistement correcte. Il existe en effet un herméneutisme et un historicisme axiologiques postmodernes, qu’il convient de ne pas confondre avec une interprétation historiciste inspirée par Hegel ou par Marx, qui s’exprime avant tout sous l’angle ou sur le terrain des valeurs, et qui n’est presque jamais hostile, entre autres, au multiculturalisme et au supranationalisme.
- En outre, il n’est pas fallacieux de dire que si la mentalité postmoderne ne prône pas avant tout la persécution des personnes chrétiennes, elle prône, en revanche, le contournement et le dépassement des objections et des principes présents au sein du christianisme catholique, en les faisant passer pour des objections et des principes qui résultent d’interprétations conjoncturelles et particulières, et non fondamentales ni universelles, qui ont eu leur autorité ou leur importance, avant-hier ou hier, mais qui n’ont pas à avoir d’autorité ou d’importance, dans le monde d’aujourd’hui, ni, a fortiori, dans celui de demain, certaines de ces objections ou principes étant, de surcroît, porteurs de « phobies » dirigées contre telle communauté, et contre les personnes attachées à telle manière de penser ou à telle manière de vivre.
- Enfin, il n’est pas mensonger de dire que si la mentalité postmoderne ne prescrit pas avant tout les agressions verbales ou gestuelles contre les personnes chrétiennes, elle prescrit, en revanche, la ringardisation et la stigmatisation « culturelles » de ces personnes, la marginalisation ou la ridiculisation « culturelles » de ces personnes, ou plutôt de celles d’entre elles qui prennent au sérieux Jésus-Christ, l’Ecriture, la Tradition, le Magistère, le Catéchisme, la Foi surnaturelle, la loi naturelle, au point de se mobiliser et de s’organiser pour résister, d’une manière explicite et spécifique, face à telle ou telle « avancée » anthropologique ou civilisationnelle postmoderne.
- Les fondements et le contenu du Credo, du Notre Père, du Décalogue, les vertus surnaturelles et théologales que sont la Foi, l’Espérance, la Charité, mais aussi ce qu’il y a de plus éclairant et de plus exigeant, au sein de l’humanisme européen évoqué ci-dessus, et ce qu’il y a de spécifique, donc de plus réfractaire à leur réduction ou à leur soumission à la grille d’analyse postmoderne, au sein des religions et traditions croyantes non chrétiennes, sont « in-com-pa-ti-bi-li-sa-bles » avec la mentalité et la moralité postmodernes, sauf à transformer la religion chrétienne en une méthode de développement personnel inspirée par, ouverte sur, la transcendance divine, mais située par-delà le vrai et le faux, le juste et l’injuste.
- Cela explique grandement pourquoi tel intellectuel, comme Alain FINKIELKRAUT, « médiatique » en ce que sa pensée est médiatisée, mais certes pas en ce qu’elle est médiatiquement correcte, est fréquemment détesté par les artisans et partisans de la mentalité postmoderne, quand il prend appui sur des données factuelles, localisés dans l’espace et dans le temps, c’est-à-dire des idées ou des actions, des catégories ou des comportements, situés dans l’esprit public ou dans le corps social, pour critiquer les incohérences et les inconséquences de la mentalité et de la moralité postmodernes.
III.
- D’une part, ce que bien des postmodernes adorent, c’est une relation adolescente ou adulescente, virtuellement narcissique, à certaines composantes de la réalité, une relation désirante à certaines idées, à certaines actions, à certains êtres, dans le cadre de laquelle l’émotion fait souvent office d’opinion, l’indignation tient souvent lieu de lucidité, le sentiment se substitue fréquemment à l’argument, d’où le conformisme, le court-termisme, le mimétisme, de certains mouvements.
- D’autre part, ce que bien des postmodernes adorent, c’est que l’on donne raison à des minorités, mobilisées et organisées, qui entendent bien faire en sorte que la société reconnaisse, dans la classe médiatique et dans la classe politique, puis dans les lois et dans les moeurs, le bien-fondé de revendications axiologisantes, comportementales, éthico-morales, communautaires et identitaires, qui sont parfois de véritables grands caprices d’hommes et de femmes qui se prennent pour des petits dieux.
- En outre, ce que bien des postmodernes détestent, ce sont des réalités et des thématiques telles que le bien commun, la véritable dignité et la liberté responsable de la personne humaine, la loi naturelle, la vérité objective, notamment et surtout quand elles sont pensées et vécues, recherchées et respectées, d’une part, en adhésion à, et en communion avec, Jésus-Christ, d’autre part, d’une manière vigilante et résistante, face à l’esprit du monde, face à la mentalité dominante, dont la mentalité postmoderne est une composante contemporaine et dominatrice.
- Enfin, ce que bien des postmodernes détestent, c’est que les individus et les communautés d’inspiration non postmoderne, face au à la mentalité postmoderne, ne consentent pas à être inoffensifs, ne se contentent pas d’être inoffensifs, ne s’y résignent pas, ne s’y soumettent pas, ne s’en satisfassent pas, ne s’en tranquillisent pas, mais soient, au contraire, contre-offensifs, au moyen et à partir d’une conception globale, alternative et indépendante, à l’égard du postmodernisme, une conception indocile ou insoumise, inspirée par une source située en amont et en surplomb.
- Chacun aura compris la nature religieuse, la substance spirituelle, du phénomène auquel nous sommes confrontés, dans le cadre de notre mise en présence du postmodernisme : celui-ci est une tentative de parachèvement de la promotion de l’homme en lieu et place de Dieu, cette tentative est fallacieusement émancipatrice et unificatrice, ne peut qu’asservir la personne à ses caprices, ou ne peut qu’apporter la division dans le cœur de l’homme ou dans les mœurs des hommes.
- Mais chacun aura également compris que s’il n’est évidemment pas question de dire oui à la conception selon laquelle l’Eglise catholique a vocation à devenir « postmoderne pour les postmodernes », il n’est pas davantage question de se laisser enfermer dans l’alternative selon laquelle les catholiques n’auraient le choix qu’entre cette « postmodernistation du catholicisme » et un enfermement « communautaire » et « identitaire » qui les contraindrait à être avant tout, voire seulement, « anti-modernes contre les post-modernes », c’est-à-dire soi-disant nostalgiques, angoissés, réactionnaires, « fa…risiens ».
IV.
- En d’autres termes, bien des catholiques philo-postmodernes voudraient bien que les catholiques vigilants et résistants, face au postmodernisme, soient accusables, humiliables, incriminables, intimidables, à cause d’une attitude, d’un comportement, qui consisterait à oublier, ou à négliger, la primauté du spirituel, de la connaissance de la Parole de Dieu, de la compréhension du message de Dieu, de la fidélité à la volonté de Dieu, de la piété et de la prière personnelles, et à surlégitimer l’importance, ou à survaloriser la nécessité, de la vigilance et de la résistance face au postmodernisme.
- Que les catholiques non philo-postmodernes ne fassent donc pas « ce petit plaisir » à ceux de leurs contempteurs et détracteurs, quels qu’ils soient, qui veulent les critiquer et les désarmer, les décourager et les démotiver, depuis l’intérieur de l’Eglise catholique, d’autant plus qu’ils ont amplement la possibilité de ne pas faire à leurs accusateurs « cette grande joie ».
- Si le rappel conclusif rédigé à présent peut éclairer les plus influençables ou les plus intimidables, ce rappel consiste à signaler et à souligner qu’en d’autres temps, des catholiques philo-communistes (ou des catholiques qui ne voulaient pas que les catholiques puissent et sachent être catholiques, et, notamment, anti-communistes), nous ont déjà fait le même coup : à les entendre, il était absolument impératif que les catholiques s’adaptent, évoluent, se conforment au sens de l’histoire, ou à leur conception, suiviste, des signes des temps, montent intelligemment et opportunément dans le train de l’évolution et de l’orientation de l’homme et du monde, et ne restent donc pas bêtement et tristement sur le quai de la gare de leurs objections rétives et de leurs positions stériles, voire néfastes ou nocives, car « beaucoup trop » catholiques pour ne pas être « quelque peu » intégristes. Or, nous savons tous que le train de l’avenir, de la justice, du bonheur, du progrès, a fini par dérailler.
- Nous sommes actuellement à peu près en présence du même type de tentative de culpabilisation intra-ecclésiale des catholiques vigilants et résistants, aujourd’hui, désormais, face au postmodernisme, parce que certains clercs voudraient pouvoir faire pactiser l’Eglise avec l’esprit du monde, voudraient pouvoir prescrire cette pactisation aux catholiques, et voudraient pouvoir proscrire, interdire aux catholiques, la vigilance et la résistance, face à cette tentative de pactisation.
- Ainsi, dans l’Eglise catholique, actuellement, presque toute tentative, doctrinale ou pastorale,
– de réduction ou de soumission du dialogue oecuménique à du consensus oecuméniste,
– d’asservissement ou d’assujettissement du dialogue interreligieux à du consensus para-religieux,
– de canalisation ou de configuration du discours de l’Eglise, sur et vers le monde contemporain, en direction d’un accompagnement fallacieusement humanisateur, qui semble presque dispenser les non chrétiens de conversion chrétienne,
est certainement bien plus d’inspiration philo-postmoderne que d’inspiration distante et prudente, ou critique et croyante, face au postmodernisme.
- A mon avis, c’est sous cet angle-là, sur ce terrain-là, que les catholiques qui savent bien qu’il existe bien une conception « catholique postmoderne »
– de la « libération », qui est plus faussement émancipatrice que vraiment libératrice,
– du « pluralisme », qui n’objecte ou n’oppose rien, face au relativisme et au subjectivisme,
– du « dialogue », qui ne repose pas sur des distinctions, mais qui découche sur de la confusion,
– de « l’unité » qui élude ou occulte des éléments porteurs de vérité, qui sont sacrifiés au consensus,
devraient pouvoir identifier la nature fondamentalement religieuse, la substance fondamentalement spirituelle, du postmodernisme. En tout cas, puissent ces quelques lignes contribuer à cette identification, qui est devenue indispensable.
Un lecteur de Riposte catholique.
(et la Rédaction tient à ajouter ce petit post de l’auteur « Et surtout : je ne suis que ceci : « Un lecteur de Riposte catholique », un lecteur parmi d’autres, car je suis convaincu que nous sommes plus nombreux que nous ne le croyons à penser ce que je viens d’écrire. »)
La ligne éditoriale de Riposte catholique cherche à sortir de la « langue de buis », peu propice à la recherche de la vérité. C’est pourquoi nous publions volontiers des tribunes libres. Nous précisons cependant que ces tribunes publiées sur Riposte Catholique n’engagent que leurs auteurs. Nous les proposons à nos lecteurs en tant que contributions au débat et à la réflexion. La Rédaction