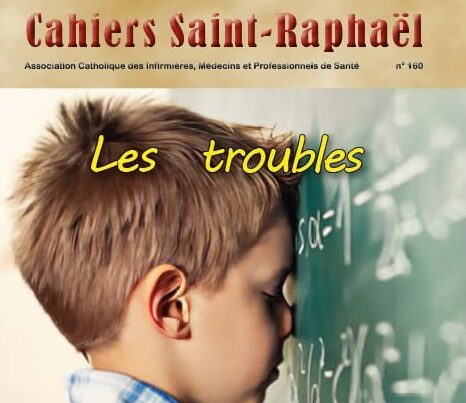C’est un vaste tiroir que celui des troubles neuro-développementaux (TND) ! On y range de nombreuses pathologies d’apparences hétérogènes mais l’évolution des connaissances en psychologie, en psychiatrie et en neurologie a permis de les unifier en faisant ressortir des éléments communs. On désigne sous ce vocable un ensemble de troubles qui apparaissent précocement, en général dans l’enfance, et qui affectent le développement du cerveau. Ils entraînent des difficultés durables dans des domaines variés comme la communication, le comportement, l’attention, l’apprentissage, la coordination motrice ou les interactions sociales. Ces pathologies sont en rapport avec la manière dont le cerveau se forme et fonctionne. Leur caractère disparate est le reflet de la diversité des fonctions cérébrales touchées par cette anomalie du développement. Cela peut expliquer leur regroupement tardif dans un dossier (ou tiroir !) commun. Quel autre rapport pourrait-on trouver a priori entre un trouble de la motricité fine et des problèmes de régulation émotionnelle ou de mauvaise interprétation des signaux sociaux ? Les causes trouvées peuvent être génétiques, neurologiques ou souvent multifactorielles. Les TND évoluent avec l’âge mais restent en général présents tout au long de la vie. C’est vers la fin du XXe siècle, avec l’évolution des classifications psychiatriques (DSM5-2013) que des comportements et pathologies d’apparences diverses, et dont le point commun n’est pas évident pour le béotien, ont rejoint ce même tiroir.
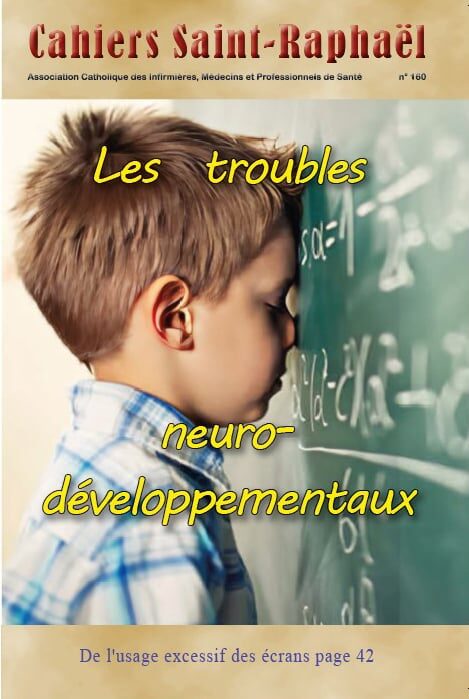 Certaines de ces pathologies semblent être apparues récemment, comme celles qui sont liées à notre mode de vie ou à notre environnement, d’autres sont probablement vieilles comme le monde, mais leur compréhension, qui s’est affinée progressivement, a permis une classification sans doute encore appelée à évoluer. Des textes de l’Antiquité ou du Moyen Âge évoquent déjà des enfants lents, rêveurs ou ayant des comportements étranges mais sans beaucoup de détails. Il n’y a alors pas vraiment de reconnaissance médicale structurée ni de traitement rationnel proposé. Au XVIIIe siècle apparaissent les prémices de la psychiatrie moderne avec notamment le docteur Jean Étienne Dominique Esquirol que nous avions déjà évoqué dans le numéro des Cahiers sur la trisomie. Certains TND étaient décrits à l’époque sous les termes d’« imbécillité » ou « idiotie » devenus aujourd’hui insultants, selon l’intensité des déficiences intellectuelles congénitales, à différencier de la démence qui est une détérioration intellectuelle acquise. Au fur et à mesure, se sont développées des méthodes éducatives pour ces « enfants arriérés », mais également des tests permettant de déterminer plus précisément l’importance du déficit cognitif (mesure du quotient intellectuel). Je laisse les spécialistes compétents qui vont intervenir dans ce numéro décrire précisément ces pathologies.
Certaines de ces pathologies semblent être apparues récemment, comme celles qui sont liées à notre mode de vie ou à notre environnement, d’autres sont probablement vieilles comme le monde, mais leur compréhension, qui s’est affinée progressivement, a permis une classification sans doute encore appelée à évoluer. Des textes de l’Antiquité ou du Moyen Âge évoquent déjà des enfants lents, rêveurs ou ayant des comportements étranges mais sans beaucoup de détails. Il n’y a alors pas vraiment de reconnaissance médicale structurée ni de traitement rationnel proposé. Au XVIIIe siècle apparaissent les prémices de la psychiatrie moderne avec notamment le docteur Jean Étienne Dominique Esquirol que nous avions déjà évoqué dans le numéro des Cahiers sur la trisomie. Certains TND étaient décrits à l’époque sous les termes d’« imbécillité » ou « idiotie » devenus aujourd’hui insultants, selon l’intensité des déficiences intellectuelles congénitales, à différencier de la démence qui est une détérioration intellectuelle acquise. Au fur et à mesure, se sont développées des méthodes éducatives pour ces « enfants arriérés », mais également des tests permettant de déterminer plus précisément l’importance du déficit cognitif (mesure du quotient intellectuel). Je laisse les spécialistes compétents qui vont intervenir dans ce numéro décrire précisément ces pathologies.
On peut noter que la grande diversité de ces TND et l’intensité variable de leurs symptômes, auront des répercussions importantes sur les possibilités d’inclusion scolaire, et ultérieurement dans la vie active, des patients présentant ces troubles. Un autiste profond nécessitera le plus souvent une prise en charge dans une institution spécialisée, certains patients atteints du syndrome d’Asperger pourront prétendre à une vie familiale ou professionnelle (au point que des hommes politiques ou chefs d’entreprise situés au-dessus du panier sont suspectés, à tort ou à raison, d’être atteints de cette maladie : Elon Musk, Vladimir Poutine…). Des aménagements spécifiques théoriquement garantis par la loi du 11 février 2005, mais pas toujours faciles à mettre en place, permettent d’inclure dans un parcours scolaire des enfants présentant des troubles déficitaires de l’attention, avec ou sans hyperactivité (TDAH), ou également des enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages (DYS). Comme pour les enfants présentant des troubles auditifs, l’importance du handicap et des adaptations pédagogiques nécessaires, la taille des classes, la compétence des professionnels et la nécessité ou non d’un équipement technologique particulier seront des éléments déterminants pour la prise en charge. Mais l’individualisation est un casse-tête pour les enseignants de classes bien remplies. Signalons au passage la question des méthodes de lecture, celle dite globale ayant été accusée d’être responsable d’un accroissement des problèmes de dyslexie. Des conversations que j’ai eues avec des orthophonistes m’ont semblé aller dans ce sens avec quelques nuances. Stanislas Morel, sociologue, critique aujourd’hui une « médicalisation décomplexée » du milieu scolaire permettant aux enseignants de se débarrasser des enfants à problèmes en les évacuant vers un professionnel de santé. Dit autrement, celui qui autrefois colonisait le fond de la classe, à proximité du radiateur, se retrouve aujourd’hui d’office chez l’orthophoniste ! La médicalisation des difficultés scolaires s’inclut dans un processus plus large de médicalisation de l’existence. Il convient d’établir précisément la frontière entre les difficultés scolaires et les vrais troubles de l’apprentissage. On peut rapporter cette évolution à la définition de la bonne santé de l’OMS publiée en préambule de sa constitution de 1946 : « La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Auparavant, dans une vision hippocratique, on parlait plus simplement de « silence des organes » c’est-à-dire d’absence de pathologie. Cela explique que des difficultés, des gênes, des inconforts, comme un nez de travers, une grossesse non désirée ou à éviter, soient aujourd’hui considérés comme relevant de la médecine.