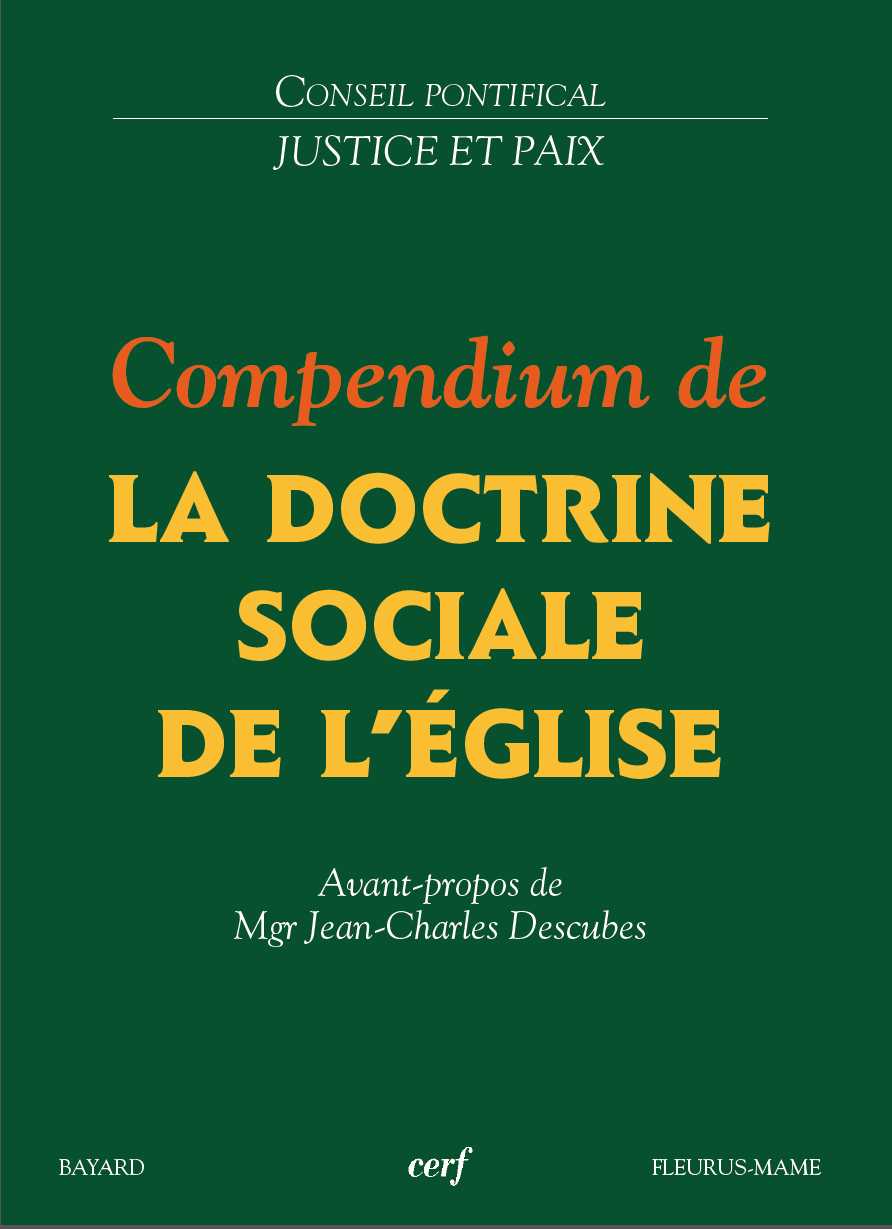De Stefano Fontana dans la Nuova Bussola :
Les interventions sociales du pape François ont sans doute été nombreuses, mais les critères de jugement ont été manifestement mondains, notamment parce que les présupposés philosophiques et théologiques de la tradition catholique, le rapport entre nature et surnature et entre raison et foi, ont été perdus.
En regardant les transformations qui ont eu lieu au cours des 12 dernières années, il est impossible de ne pas remarquer que pendant le pontificat de François, la trace de la Doctrine Sociale de l’Eglise (DSE) a été perdue. Non seulement l’expression n’a plus été utilisée, ni ses principes et critères d’évaluation des nombreux nouveaux phénomènes sociaux, mais surtout ses présupposés philosophiques et théologiques ont disparu, sans lesquels elle se réduit à un moralisme social et à un humanisme générique solidariste. Le cadre de ces fondements a tenu, bien que difficilement, jusqu’à Benoît XVI, puis beaucoup a été perdu et ceux qui avaient cultivé leur engagement pour la DSE ont été mis à rude épreuve. À partir d’un certain moment, ce qui avait été dit et fait auparavant ne pouvait plus être dit ou fait. Du jour au lendemain, un nouveau modèle s’est imposé.
Le principal de ces postulats est la relation correcte entre la nature et la surnature, et donc entre la raison (y compris la raison politique) et la foi religieuse. Il est bien connu que la théologie des universités pontificales n’utilise plus ces mots à consonance métaphysique, remplacés par la perspective historique et existentielle, beaucoup plus horizontale. Mais sans elles, la DSE devient impossible, c’est-à-dire le regard de Dieu sur la communauté humaine, avec toutes ses exigences salvatrices, qui rencontre les vérités de la raison politique, les renforce et les purifie.
La DSE doit être fondée sur la Parole du Christ Sauveur et sur la vérité de la raison naturelle qui vient en dernier ressort du Christ Créateur. La DSE doit être fondée sur un ordre naturel et finaliste, inhérent à la nature sociale de l’homme et capable, malgré la situation de déchéance consécutive au péché, d’atteindre les préambules de la foi, afin de permettre à la Parole d’être exprimée dans un langage compréhensible.
Dans cet ordre naturel finaliste se trouvent les principes de la morale sociale et politique, que la révélation confirme et que l’Église protège, sans lesquels il n’y a pas de DSE, car le concept de bien commun et le fondement de l’autorité politique disparaîtraient. La DSE a besoin du droit naturel et de la morale naturelle.
Sous ce pontificat, cependant, les concepts mentionnés ci-dessus n’ont plus été repris. La loi naturelle et la morale naturelle n’ont plus été remises en question. Les principes non négociables, qui émanent de la loi naturelle, ont été niés et oubliés. Une Église englobant tous les comportements a été proposée, selon laquelle il n’y a que l’être et non plus le devoir être, puisque Dieu nous aimerait non seulement tels que nous sommes mais aussi tels que nous restons, une Église qui ne juge pas les événements historiques mais les accompagne. Une Église qui ne se réfère qu’à la miséricorde en négligeant la vérité se trouve en décalage avec les exigences de la DSE, qui est de juger l’histoire et le monde à la lumière de la raison naturelle et de la révélation.
Cette absence de perspective de droit naturel était également évidente dans les documents de nature non strictement sociale ou politique. La nouvelle interprétation de l’adultère dans Amoris Laetitia ne tient pas compte du fait qu’elle va à l’encontre de la loi naturelle et pas seulement de la loi divine. La bénédiction des couples de même sexe dans Fiducia supplicans oublie que c’est la raison naturelle elle-même, avant les normes évangéliques, qui dit qu’ils ne sont même pas des couples. Une telle négligence dans l’ordre de la raison naturelle a des répercussions sur la DSE, qui fonde la société sur la famille et le mariage. L’ouverture à la reconnaissance juridique des unions civiles, même homosexuelles, exprimée directement par François lui-même, l’encouragement des mouvements en faveur du transgendérisme ont affaibli, voire rendu impossible, la cohérence entre foi et politique sur laquelle repose la DSE. Jamais comme sous ce pontificat, les fidèles laïcs n’ont ressenti le malaise de ne plus être organiquement guidés et formés dans leur engagement dans le monde.
Si l’on examine les interventions de François sur les questions de morale sociale, on se rend compte qu’il s’est toujours adressé à tout le monde, indifféremment, et jamais aux catholiques et aux croyants. Les discours aux mouvements populaires de toutes sortes, les interventions directes aux fondations mondialistes, les messages aux mouvements pour les « nouveaux droits »… n’ont jamais parlé du Christ. Adressées à tous indifféremment, avec un critère extensif et inclusif, ces interventions n’étaient donc qu’à hauteur d’homme. Jean-Paul II écrivait dans Centesimus annus que la DSE était l’annonce du Christ dans les réalités temporelles et qu’elle avait pour but l’évangélisation, dont elle était un instrument. Rien de tout cela dans le pontificat de François, au cours duquel l’évangélisation a été exclue comme une forme de prosélytisme, et le chrétien a été invité à s’occuper des pauvres mais plus à construire la société, dont les critères architecturaux sont conservés dans la DSE.
Les principes et les critères de la DSE n’ont jamais été utilisés pour aborder les principaux processus en cours dans nos sociétés, tels que Covid, l’immigration, l’environnement, l’unification européenne. On a préféré intervenir au cas par cas, en posant des questions plutôt qu’en indiquant des réponses, en favorisant un discernement des consciences qui se perd sans doctrine, en proposant l’Église comme accompagnatrice et non plus comme guide. Il s’est ainsi trouvé que, finalement, sur les grandes questions évoquées plus haut, l’Église a été absente, finissant par s’aplatir aux courants les plus forts du mondialisme ambiant. Et, qui plus est, heureuse d’être absente, considérant ce positionnement comme plus « évangélique ».
Quelqu’un pourrait nous rappeler que François a également écrit deux encycliques proposées et considérées comme ayant un caractère social, Laudato si’ (18 juin 2015) et Fratelli tutti (3 octobre 2020). Dans ces conditions, comment peut-on dire qu’il a négligé la DSE ? Laudato si’ est consacrée à un thème sectoriel, l’environnement, contrairement aux encycliques précédentes ; sa rédaction, de l’aveu même de François, est due à Leonardo Boff ; une grande partie de son texte reprend les clichés sur l’environnementalisme chers à la presse du régime ; il y a de sérieuses concessions à la vision de l’homme comme partie d’une plus grande terre mère et à des formes économiques, comme la décroissance heureuse, déjà critiquée par Benoît XVI. C’est à cette encyclique que l’on doit le « délire écologique » de tant de conférences épiscopales et de communautés chrétiennes et leur alignement sur les projets des grands de ce monde en la matière. Quant à Frères tous, l’encyclique prétendait fonder la fraternité entre les hommes non pas sur la nature humaine commune, fruit de la création et de l’élection comme fils par le Père, mais sur le fait d’être « dans le même bateau », c’est-à-dire sur une solidarité purement existentielle. Ces deux encycliques ne peuvent être considérées en continuité avec l’ensemble de la tradition de la DSE.