 C’est la question que pose en forme de titre de son dernier ouvrage (éditions de l’Emmanuel, 238 pages, 19€), le père Denis Biju-Duval, prêtre de la communauté de l’Emmanuel, actuellement consulteur au Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation et professeur de théologie de l’évangélisation à l’Institut pontifical Redemptor Hominis de l’Université du Latran.
C’est la question que pose en forme de titre de son dernier ouvrage (éditions de l’Emmanuel, 238 pages, 19€), le père Denis Biju-Duval, prêtre de la communauté de l’Emmanuel, actuellement consulteur au Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation et professeur de théologie de l’évangélisation à l’Institut pontifical Redemptor Hominis de l’Université du Latran.
Dans les années de l’immédiat après-Concile, une telle question aurait paru scandaleuse. Pour beaucoup, aujourd’hui encore, elle n’attend qu’une réponse négative. Le salut apparaît acquis à tous, quand on a encore une vague notion de ce qu’est le péché et la vie éternelle.
Dans cet ouvrage, l’auteur exonère le concile Vatican II de toute responsabilité dans le long silence sur cette question qui a fait suite à des siècles de souci pour le salut des âmes. Le père Biju-Duval estime ainsi que le silence contemporain forme comme un retour de balancier à une exagération inverse, de tendance janséniste. Mais son livre a au moins le mérite de remettre la question sur le devant de la scène. C’est au moins l’occasion de souligner quelques bonnes vérités. Il écrit ainsi dans sa conclusion :
Selon la révélation en effet, c’est au prix de la Croix que le Christ nous réconcilie avec le Père. Aussi, réduire la miséricorde à un bon sentiment universel et vague dissout le visage personnel de Dieu et le drame de la passion. On confine alors à une sorte de panthéisme subjectiviste, qui permet de peu coûteuse identification entre l’amour divin et nos propres sincérités. On se dispense ainsi de toute conversion sérieuse.
Il y aurait évidemment beaucoup de distinctions à apporter dans les affirmations de l’auteur. Mais il semble que la voie générale soit la bonne. Il le dit lui-même : il n’est pas nécessaire de dépoussiérer la nécessité du bon zèle pour le salut des âmes car celle-ci appartient à la nature même de l’Église et elle ne cesse pas d’exister malgré les crises que l’Église peut traverser. Il ne nie pas pourtant une certaine éclipse et ses conséquences dramatiques :
Le zèle pour le salut des âmes n’a pas disparu de la vie de l’Église : il continue d’inspirer de par le monde des millions de chrétiens, de pasteurs et de missionnaires dans le témoignage en paroles et en actes qu’ils rendent à l’Évangile, parfois jusqu’au martyre. Son expression spirituelle, communautaire et intellectuelle rencontre il est vrai différents obstacles dont nous avons tenté de cerner la nature. N’étant plus formalisé théologiquement comme il était par le passé, ce zèle apostolique a plus de mal à s’exprimer, et bien des crises personnelles et communautaires peuvent en procéder ainsi que, ici ou là, de vrais reculs du christianisme.
Au terme de son ouvrage, il donne donc comme exemple de zèle missionnaire Mère Teresa, en spécifiant, au sujet des propos de la fondatrice des Missionnaires de la Charité :
Ces expressions proviennent de la grande tradition chrétienne. Le fait est que loin de disparaître chez elle au moment où à partir des années 60, elles perdaient en crédibilité dans bien des milieux d’Église, elles demeurent récurrentes en sa bouche et sous sa plume jusqu’à la fin de sa vie. Il est évident par ailleurs qu’elles ne souffrent chez d’aucune des mésinterprétations que l’on a pu constater en d’autres milieux : nul jansénisme dans la charité universelle qui l’animait, nul platonisme dans son service des pauvres qui unissait sans difficulté soins corporels les plus humbles et le désir du salut des âmes, nul individualisme du salut dans cette contagion de la charité prenant source dans une communauté religieuse pour mieux faire resplendir le visage de l’Église entière.


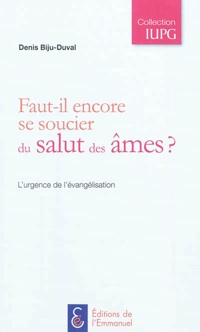



La foi en la vie après la mort et en la résurrection précède le souci du salut des ames qui en est la conséquence