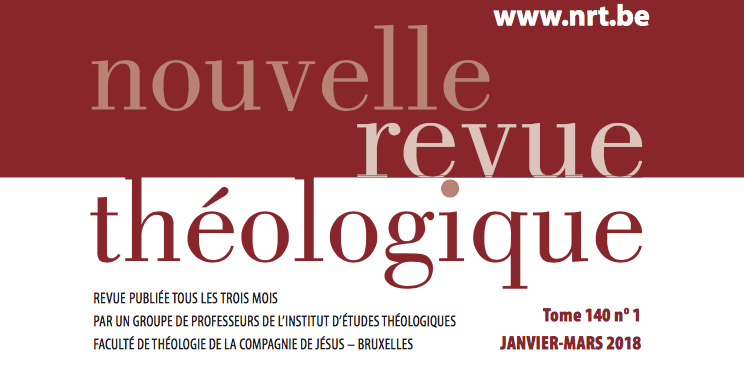Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, livre dans la Nouvelle revue théologique une analyse sur le drame des abus sexuels dans l’Eglise. Dans ce texte de 20 pages, il trouve le moyen de ne pas parler d’homosexualité…
Concernant l’attitude des évêques, il écrit :
Le principal reproche formulé publiquement contre les évêques est d’avoir voulu protéger l’institution. Il nous paraît trop général et peu explicatif. S’en contenter risquerait d’empêcher de repérer des motiva- tions plus profondes, moins faciles à expliciter.
D’abord, il nous est apparu, en découvrant un certain nombre de récits, qu’il est très difficile de se représenter ce dont il s’agit tant qu’on n’a pas rencontré et entendu les personnes victimes en les écoutant vraiment. Quelque chose dans l’esprit humain se refuse à accepter qu’existent de telles violences ; cette réaction empêche qu’une écoute sérieuse soit accordée à celui ou celle qui porte le récit et qu’une enquête réelle soit menée. Ce qui est dénoncé est sinon nié, du moins ramené à des proportions qui paraissent acceptables. Un responsable ecclésial qui, il y a cinquante ans ou quarante ans ou trente ans, apprenait qu’un prêtre avait agressé sexuellement un enfant ou un jeune ne réalisait pas forcément de quoi il s’agissait : il ne pouvait imaginer qu’un prêtre et tout simplement qu’un homme puisse avoir des pulsions qui le rendent prédateur pour ceux qui lui sont confiés ; il ne pouvait imaginer qu’un prêtre puisse prendre un adolescent dans ses bras à chaque rencontre et ce, pendant des années. D’où la tendance à minimiser les faits, à estimer les récits exagérés. D’où, plus subrepticement et plus gravement, la volonté plus ou moins exprimée de ne pas vouloir en savoir plus. De là, des mesures visant seulement à éviter le scandale.
De plus, le silence a parfois (pas toujours, notons-le) été requis par les familles elles-mêmes. Les parents des enfants agressés avaient souvent été des amis du prêtre agresseur, ou avaient été pleins d’admiration pour lui. En plus d’un cas, les parents avaient confié tel de leurs enfants à ce prêtre ou avaient encouragé leurs rencontres, sans s’étonner de la fréquence des rendez-vous, sans s’inquiéter de leur longueur. Que peuvent se dire un homme de 40 ou 50 ans et un jeune adolescent de 12 ou 15 ans ? En tout cas, l’institution à préserver n’était pas l’Église seule mais la totalité du système social. Car Église, familles, société politique et société civile, dans la totalité qu’elles forment, sont ébranlées par les actes d’agression sexuelle contre des mineurs. Comment construire la société si l’on ne peut faire confiance aux adultes qui jouent un rôle social largement esti- mable ? Ne pas faire de vagues a pu être jugé nécessaire pour traiter au mieux, c’est-à-dire dans cette optique, sans ébranler le système social, des cas dont on estimait, sans trop le vérifier et en s’empêchant par là même de le faire, qu’ils étaient marginaux, qu’ils appartenaient aux franges obscures de toute réalité terrestre.
Mais trois facteurs non analysés conditionnaient aussi la réaction des autorités ecclésiastiques.
Le moins regardé d’entre eux nous paraît avoir été le suivant : on – et « on » ici veut dire à peu près tout le monde : évêques, magistrats, parents, policiers… – pensait sans trop le dire que les enfants victimes de ce genre d’actes en grandissant allaient oublier ou, du moins, surmonter la violence subie. Comme une jambe cassée peut provoquer sur le moment un grand trouble, susciter des mois, voire des années pénibles, mais un trouble que la croissance et la force de vie des enfants dépassent spontanément, l’enfant avançant dans l’existence allait passer à autre chose, retrouver un équilibre nouveau. Le fait nouveau, devenu indéniable depuis 2016, est qu’il est désormais clair que les enfants n’oublient pas vraiment ; ils peuvent enfouir les faits subis, mais ceux-ci sont et restent un traumatisme qui complique ou entrave, en chacun de manière différente, sa construction personnelle. La conviction non dite, non examinée, que les enfants dépasseraient cela dont on supposait aussi peut-être qu’ils n’avaient pas mesuré la gravité, explique l’irresponsabilité dont on (un « on » toujours aussi ample et indistinct) a fait preuve à leur égard.
Le deuxième facteur est une conception elle aussi confuse de la miséricorde. L’autorité ecclésiastique et, parfois, l’autorité judiciaire, ont eu tendance à considérer qu’il s’agissait de l’égarement d’un moment qu’une remontrance et la honte que ce fait soit connu de l’autorité suffiraient à empêcher de se reproduire. L’autorité n’a pas su – et sans doute pas voulu ‒ examiner davantage les causes profondes de ces actes dont, souvent, pour la raison dite plus haut, elle n’a pas su voir l’ampleur. Les évêques ou les supérieurs religieux ont donc estimé que la miséricorde les obligeait à faire confiance en la bonne volonté du prêtre coupable, à l’aider à avancer sans l’enfermer dans sa faute, souvent en tâchant de changer ses conditions de vie soit pour l’éloigner au moins un peu de la tentation (mais jamais assez nettement) soit pour remédier à telle ou telle cause de déprime ou de perte de dynamisme spirituel.
Un élément important du traitement du pardon a été négligé, et cette négligence révèle quelque chose de l’état spirituel du temps où nous sommes : la réparation, c’est-à-dire ce qui, en tout état de cause, est dû à la personne victime. Pour éviter toute confusion, précisons que « réparation » ne désigne pas ici principalement la compensation des préjudices matériels, psychologiques ou moraux subis par un paiement financier imposé au coupable, mais le processus plus fondamental qui fait que le coupable prend sur lui au moins une part du poids du mal qu’il a causé. Parce qu’on ne réalisait pas (mais, nous venons de le dire, on n’y avait guère réfléchi) les dégâts produits chez le ou les enfants, on a pu penser qu’un éloignement géographique des lieux de la « chute » ou une mise à l’écart d’un ministère éducatif (mais en négligeant souvent que les prêtres rencontrent des enfants ou des jeunes de mille manières dans l’exercice ordinaire du ministère) pouvaient suffire à remettre le prêtre coupable sur le bon chemin et lui permettraient de se rattraper dans un service nouveau. C’était malgré tout oublier que le pardon suppose que le coupable reconnaisse le mal qu’il a commis et en assume la gravité. La miséricorde du Christ ne consiste jamais à nous faire penser que le péché ne serait pas si grave mais au contraire à nous en révéler le caractère toujours mortifère dans l’acte même où il nous pardonne, de telle façon que nous puissions devenir acteurs de notre conversion, acquérir pro- gressivement la détestation du péché et le désir de vivre autrement. Dans la structure même du sacrement du pardon, la « pénitence » ou « réparation » sert à cela : elle est souvent réduite aujourd’hui à quelque lecture ou récitation mais son sens originel de « réparation », évident en cas de vol du moment que la restitution est possible, aurait pu et devrait désormais éclairer le plein mouvement de la miséricorde. C’est parce qu’ils avaient perdu le sens de la réparation que des responsables ont pu oser engager les personnes victimes à pardonner à leur agresseur, comme si ce qu’elles avaient subi pouvait être nettoyé comme une simple tache sur un linge, comme si l’abus éprouvé ne s’était pas inscrit en elles très pro- fondément et comme si le pardon se réduisait à une amnésie sur commande.
Le troisième facteur a déjà été quelque peu indiqué : beaucoup parmi les prêtres qui se sont rendus coupables d’actes délictueux mettaient depuis longtemps l’autorité ecclésiale mal à l’aise, mais pour des raisons toutes différentes. Leurs charismes, leurs exigences, les œuvres qu’ils avaient fondées, le milieu dont ils s’étaient entourés rendaient compliquées leurs relations avec les autres prêtres ou une partie des autres prêtres et ne laissaient guère à l’autorité la possibilité de les employer à autre chose que ce qu’ils avaient choisi, sauf à risquer d’être accusée de « couper les têtes qui dépassent un peu », de jalouser les prêtres de talent, de vouloir faire entrer tout le monde sous le couperet des « plans pastoraux ». Souvent, l’autorité n’aurait jamais soupçonné ce qui a été découvert ensuite, mais l’embarras où elle se trouvait, même mal justifié, était un signal. Un certain nombre de ces prêtres se sont complus intérieurement dans un sentiment de « toute-puissance », s’autorisant parfois explicitement à s’affranchir des lois. D’où, désormais, une question délicate : comment tenir compte des signaux sans pour autant soupçonner tout prêtre ayant un peu de créativité pastorale et de rayonnement ? Quelles conditions réunir pour permettre à chacun de déployer ses talents avec liberté sans se laisser glisser vers des fonctionnements pervers ?